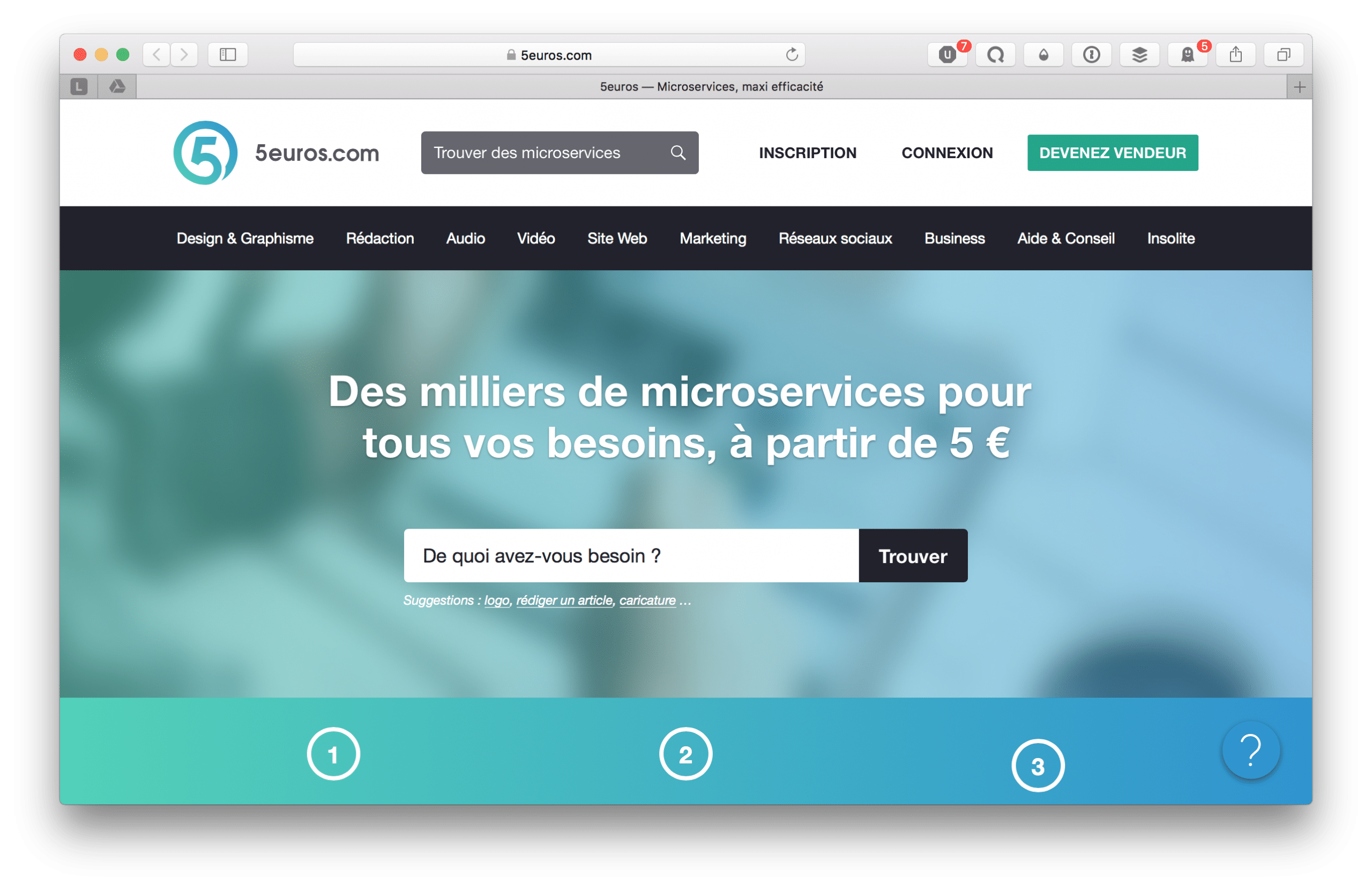J'évolue dans un milieu (associatif, éducatif, service public) où le terme marketing est très mal vu. Au départ, j'étais tout honteux de faire du marketing. Bouh, le vilain mot !
J'avais d'ailleurs gardé un souvenir très mitigé d'un de mes stages de webmarketing. Ma mission consistait à optimiser des campagnes Facebook pour inciter des jeunes à découvrir de nouveaux MMORPG (jeux de rôle massivement multijoueur).
Ce stage n'a pas été dénué d'intérêt, ne serait-ce que parce qu'il s'est déroulé dans une startup berlinoise en pleine croissance. Mais je ne m'y retrouvais pas à plein de niveaux, et surtout, je n'y voyais pas de sens. Pas d'impact. Pas de gain, ni pour la cible de mes campagnes, ni pour moi.
Lire la suite