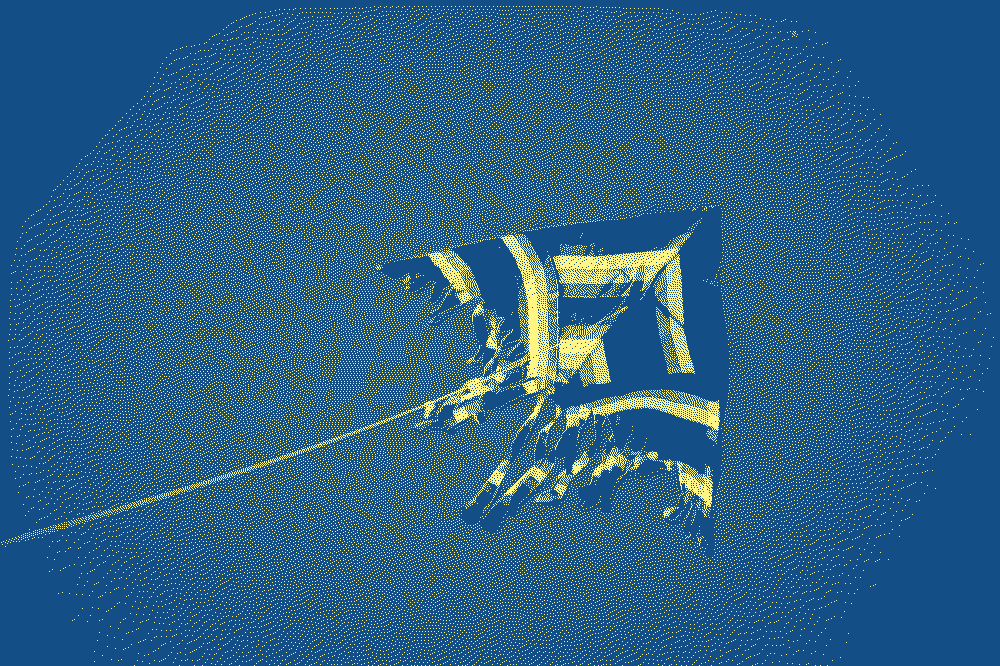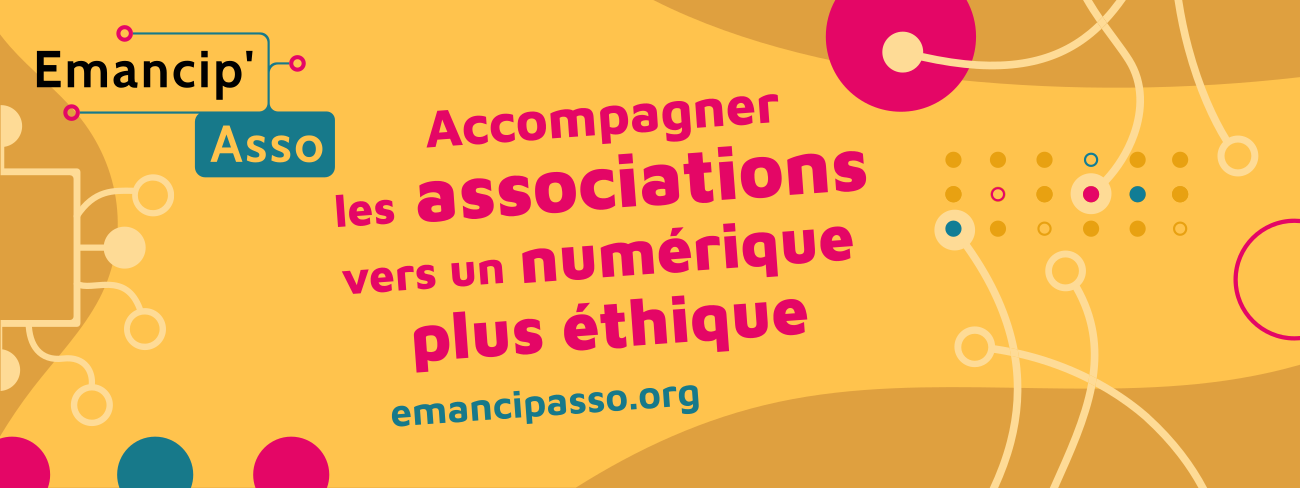Arrêtons de parler de numérique, de GAFAM, d'écrans ou de cloud
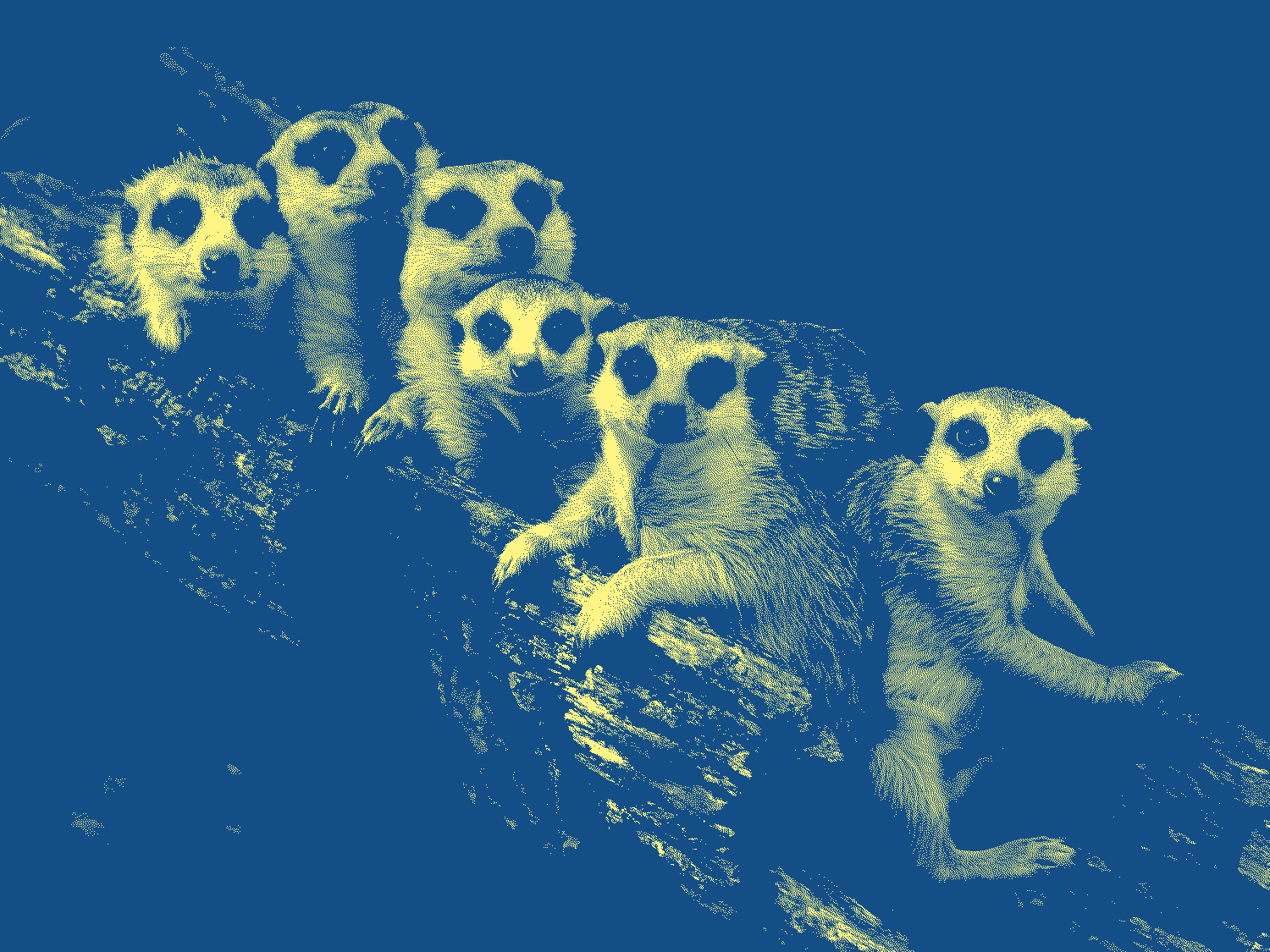
Le choix des mots est important, quel que soit le contexte. Pour paraphraser Camus, mal nommer les choses en connaissance de cause, c'est contribuer au malheur du monde, en tout cas favoriser le statu quo. Si l'infrastructure numérique est si peu politisée, c'est en partie parce que nos mots la dépolitisent, parfois subtilement. C'est le cas lorsque l'on utilise des termes vagues et fourre-tout : numérique, écrans, intelligence artificielle. Ou lorsque nous parlons de cloud, de dématérialisation, et que nous contribuons à donner l'image d'une infrastructure immanente, invisible, dont il ne faudrait pas se (pré)occuper. Je crois qu'une partie de la politisation de nos choix technologiques passe par une bataille sémantique, une reconquête des mots. Cela demande un peu d'effort de précision, et souvent de vulgarisation. Mais je crois que c'est essentiel, et même, que c'est aussi ça, éduquer [au numérique] les citoyen⋅ne⋅s d'un monde numérisé.
Ne parlons plus de numérique. En tout cas, parlons-en le moins possible. « Le » numérique, cet adjectif technique, devenu adjectif commun puis substantif, ne veut plus rien dire. On peut parler de numérique pour évoquer des drones tueurs ou un langage de programmation, Facebook ou un Wikipedia, un microprocesseur ou imprimante 3D. Préférons-lui le terme de technologies numériques. Ou d'équipements numériques. Ou d'outils numériques. Et précisons toujours de quel numérique nous parlons.
Ne parlons plus de GAFAM. Cette dénomination est pratique, mais trompeuse. D'une part, elle associe cinq entreprises qui partagent certes des caractéristiques communes (parmi les plus grosses capitalisations boursières du monde, des modèles économiques fondés sur l'effet réseau et les rendements croissants), mais diffèrent sur de très nombreux aspects essentiels : modèle d'affaires, stratégie commerciale, valeurs affichées et pratiquées, attention portée à la vie privée, etc. D'autre part, elle omet d'autres très grosses entreprises de l'économie numérique, qui méritent toute notre attention : Tesla, Nvidia, TwitterX, mais aussi les chinoises Baidu, Huawei, Alibaba Group, Tencent et Xiaomi. Il y en a bien d'autres, encore plus discrètes, et pourtant cruciales à l'infrastructure numérique actuelle. Préférons au terme de GAFAM celui de multinationales du numérique. Ou de géants du numérique.
Ne parlons plus de cloud. Ne parlons pas plus de nuage. Ces termes contribueront à « dématérialiser » l'infrastructure numérique, à l'invisibiliser. Ce qui est invisible ou magique est difficile à politiser. Cela nous empêche de penser la fragilité de l'infrastructure numérique (il faut l'incendie d'un centre de donnée pour s'en rappeler), tout comme son impact écologique et social. Préférons-lui le terme de plateforme de services numériques.
Ne parlons plus de dématérialisation, pour parler des services publics ou privés par exemple. Ce terme contribue lui aussi à faire croire que remplacer des humains par des machines numériques aurait comme conséquence moins de matériel. Ce qui est évidemment faux, compte tenu de la réalité de l'infrastructure numérique nécessaire pour transformer les organisations publiques et privées. Préférons-lui le terme de numérisation. Dans certains cas, et dans un registre plus critique, on peut aussi parler de déshumanisation.
Ne parlons plus des écrans. Ou alors, parlons-en moins, car ce terme présente deux écueils principaux. Celui de fondre tous les appareils numériques (télévision, tablette, smartphone, ordinateur fixe, etc.) équipés d'écran en une seule dénomination. Ainsi que celui de donner l'impression que nos seules manières d'interagir avec les outils numériques sont de passer par un écran, ce qui n'est pas vrai. Il suffit de penser à l'essor des enceintes connectées, par exemple. Ou rappeler que les « écrans » sont la face émergée de l'iceberg numérique, composé d'une infrastructure cachée, matérielle et complexe (composants électroniques, câbles, routeurs, centres de données et de traitements, processeurs qui font tourner des algorithmes). Préférons-lui le terme d'outils numériques, pour parler d'artefacts permettant d'interagir avec des informations numériques. Ou de contenus numériques s'il faut parler desdites informations numériques, les qualifier, les critiquer. Parlons enfin d'interfaces numériques, pour parler de dark patterns, de captation de l'attention, de design.
Ne parlons plus d'Intelligence artificielle. Comme « le numérique », ce terme ne veut pas dire grand-chose, si ce n'est regrouper « l'ensemble de théories et de techniques visant à réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine » (source : Wikipedia). Dans ce terme flou, de très nombreux algorithmes font en réalité des choses très différentes, de manière parfois très différentes. Rien à voir entre ce que fait ChatGPT et une IA chargée de détecter des cancers sur des radios, par exemple. Beaucoup a aussi été écrit sur notre tendance à anthropomorphiser des techniques, en comparant en l'occurrence l'intelligence artificielle avec l'intelligence humaine. Mais aussi l'apprentissage [profond] avec l'apprentissage humain. Sans parler des réseaux de neurones. Préférons-lui le terme d'outils statistiques générateurs de contenus. Ou celui d'automates computationnels, comme le propose Anne Alombert. Ou encore le terme plus global de systèmes algorithmiques d’aide à la décision. Soyons précis, car la hype de l'IA est encore devant nous.
Ne parlons plus des jeunes pour parler des enjeux du monde numérique. D'abord parce que la jeunesse n'est qu'un mot, comme disait Bourdieu. Ensuite parce que les technologies et usages numériques s'appréhendent principalement au prisme des inégalités sociales, culturelles, linguistiques, économiques. Pas tant au prisme générationnel.
Si cet article vous a intéressé, peut-être voudrez-vous poursuivre avec celui-ci : Numérique responsable, critique d’un oxymore. Ou celui-ci : Transformer le numérique : des pistes pour un alternumérisme radical.
Cet article m'a été en partie inspiré par une intervention d'Ophélie Coelho à Numérique en Commun, merci à elle pour tout son travail, et notamment son livre, Géopolitique du numérique - L'impérialisme à pas de géants.